JEWISH TIMES
Avant son alyah, Gilles Bernheim se confie longuement au Times of Israël
Quand il s’agit de parler de lui, la parole du Grand Rabbin Gilles Bernheim se fait rare, voire rétive. Se livrer n’est pas l’exercice favori de l’enseignant qui n’aime rien tant que transmettre la sagesse des Textes. Mais il a accepté, séduit par l’idée d’un vagabondage littéraire.
Promenade littéraire, donc, faite à grandes enjambées et de façon subjective et qui, au moment d’emprunter un chemin de traverse, au détour d’une question sur la fin précipitée de son mandat de grand rabbin de France, après avoir été accusé de plagiat et d’avoir menti sur l’obtention d’un diplôme d’agrégation de philosophie, a décidé de rebrousser chemin pour reprendre le cours de ce pour quoi elle avait été prévue : un hommage sincère et enrichissant.
L’imminence de son alyah a permis de le « saisir » à un tournant de son existence, dans un entre-deux, un temps suspendu unique où les souvenirs se mêlent aux projets et la nostalgie à la joie d’être bientôt en Eretz.
Son enfance savoyarde, ses maîtres, la littérature, ce qu’être Juif veut dire, le sport qu’il aime tant, l’art d’être grand-père, son expérience de Grand Rabbin de France qu’il juge trop courte… Autant de thèmes égrenés au débotté.
Rencontre, quelques jours avant l’hommage qui va lui être rendu, ainsi qu’à son épouse Joëlle – fondatrice du Centre d’Etudes Juives Au Féminin – à la synagogue de la Victoire, retransmis par zoom, contexte sanitaire oblige.
The Times of Israël : Que représente l’alyah pour vous, Monsieur le Grand Rabbin, à quelques semaines de votre installation à Jérusalem ?
Gilles Bernheim : La première source de bonheur de notre alyah : voire naître, grandir et vivre nos petits-enfants. Vivre à Jérusalem a longtemps été le point de rencontre entre la nostalgie et l’espérance. Aujourd’hui, elle est aussi, magnifiquement et difficilement, présence mais aussi responsabilité pour tous ceux qui y vivent et ceux qui se réclament d’elle.
De fait, il nous est relativement facile de chanter Jérusalem, il est plus malaisé de la saisir vraiment, au-delà de son charme exceptionnel, dans sa lumière, sa complexité et la plénitude de son sens. La pluralité extrême des communautés qui la composent et qui en font comme un microcosme pourra le mieux être préservée si, plutôt que de rechercher une unité factice parce que contraire à son histoire et à sa vocation, on pouvait réussir à restituer le plus haut degré de compréhension et d’entente. Entente d’ailleurs tout aussi impérative à l’intérieur même des communautés qu’entre celles-ci.
Au moment de retrouver Jérusalem me reviennent les paroles de Théodor Herzl. Il se disait en 1898 convaincu que l’on pourrait construire hors des vieilles murailles de la ville une merveilleuse Jérusalem nouvelle. À Herzl, la réalité a répondu : l’Université hébraïque, une myriade de yeshivot et de centres d’étude pour les femmes, le musée qui abrite, dans le sanctuaire du Livre, les manuscrits de la mer Morte, le mont Herzl lui-même, la Knesset et, à Ein kerem, l’hôpital Hadassah où rayonnent une médecine réputée mais aussi la lumière des vitraux de Chagall. Il faut y ajouter Yad Vashem qui, sur un rocher abrupt, devant un paysage autrefois désolé, commémore le massacre des Juifs par Hitler. Sur une immense dalle de marbre noir pauvrement éclairée par un feu du souvenir, des noms sont inscrits, tous ceux des camps de la mort où ont péri six millions de Juifs. C’est tout ça, Jérusalem.

Mais le rav Avraham Itz’ak Hacohen Kook disait que Jérusalem, capitale où se réunissent et convergent toutes les mémoires, est aussi un lieu complexe, un haut lieu de l’intelligence et de la sagesse, et le refuge parfois de certains fanatismes. L’air de Jérusalem est parfois lourd à respirer, comme l’a écrit Yehouda Amihaï.
Si nous sommes amoureux de cette ville, c’est aussi parce que nous saurons – peut-être – avoir un rôle difficile mais essentiel à y jouer. Même tout petit !
L’alyah comporte une dimension pragmatique qui en fait un « grand déménagement ». Tentons d’imaginer la posture de l’intellectuel au milieu de ses cartons, plongé dans une longue et profonde méditation quant au choix de ce qu’il convient d’emporter et de ce à quoi il lui faut renoncer. Sans verser dans le portrait caricatural du penseur déstabilisé par la difficulté de la tâche, n’est-ce pas ce qui s’est produit ?
Au milieu des cartons, on ne réfléchit pas, on agit. Les états d’âme, c’est avant ou après.
L’un des problèmes majeurs de notre déménagement est celui des livres car l’espace pour les accueillir à Jérusalem est moindre qu’à Paris. Les bons livres sont comme des amis et il a fallu longuement – et lentement – séparer les vrais amis des faux.
Pour moi, lire n’est pas tant associé au retour sur soi mais à l’accueil. Lire, ce serait comme être prêt à « recevoir » un invité chez soi : accueil à la pensée, à l’amour et au désir des autres par la pratique de la lecture ou la connaissance des arts. C’est apprendre, avec d’autres, à écouter.
Lorsque Charles Péguy écrit qu’un grand penseur est quelqu’un qui écoute mieux que les autres, je le comprends infiniment car les êtres et les choses traversent ces hommes et cela, chaque poète le sait. Montaigne et Pascal nous ont eux aussi appris, bien après les maîtres du Talmud, que le but de toute éducation consiste à ne pas avoir peur d’être assis dans une chambre silencieuse. Or une très grande majorité des jeunes… et des moins jeunes ne peut plus lire, ni même marcher sans écouter de la musique. Ce phénomène démontre à quel point nous avons peur de la rencontre.
« Au-delà de l’Europe des patries qui ont fait leur place dans le monde, il y a celles qui n’ont pas forcé les portes de l’Histoire ».
Quelles régions resteront-elles gravées dans votre souvenir et dans cœur ?
La Savoie, ce sont des souvenirs d’une enfance très heureuse, des paysages et des massifs propices au ski, au vélo, à l’alpinisme… Si je devais privilégier un seul paysage parmi mille autres : le massif des Bauges, havre de paix qui s’ouvre à vingt kilomètres environ de ma ville natale, Aix-les-Bains.
Mais si je devais choisir un jardin protégé où vivre mon amour de la vie, alors ce vrai refuge serait dans un jardin suspendu, à deux mille mètres d’altitude, dans ce bout de monde au-dessus du monde qu’est la haute-Engadine, au-delà du col de la Maloya. On y accède comme dans un rêve, en s’élevant souvent au-dessus de la zone des nuages, par le col du Julier ou celui de la Maloya. Ce jardin suspendu appartient à la Suisse et nulle part ailleurs son enchantement n’est aussi puissant que dans cette haute vallée.
Je sais ce que j’aime dans ce bout du monde. Ce vieux pays dialectal de la haute-Engadine nous fait savoir ce que l’Occident aurait été sans les pesanteurs et les fatalités de l’Histoire. Au-delà de l’Europe des patries qui ont fait leur place dans le monde, il y a celles qui n’ont pas forcé les portes de l’Histoire. Elles ne sont pas devenues des puissances. Ce sont des réalités poétiques qui maintiennent un art de vivre, une sagesse. Elles ont conservé les antiques traditions qui les unissent à l’existence quotidienne. On y touche quelque chose de très ancien, quelque chose aussi de tout neuf, quelque chose qui participe à la jeunesse du monde.
C’est pour cela que ce pays de lacs, de pierres et de forêts est pour moi comme un jardin de vie où la nature a pris sa revanche sur l’histoire, où les événements semblent dérisoires et où tout s’accorde à une profonde durée.
Vous avez rendu un hommage ému et émouvant au Grand Rabbin Jonathan Sacks zal avec lequel vous avez déclaré avoir eu « une amitié élective ». À cette occasion, vous avez également parlé de l’effort accordé à la notion de doute. De quelle nature est ce doute ? Relève-t-il de la capacité d’accepter que l’autre peut avoir en partie raison ?
La difficulté de votre question réside dans le fait que la frontière qui partage le bien et le mal passe au travers des peuples, des partis, des idées de tous les camps. Parfois vous entendez la voix de la haine, du mépris ou de l’indifférence dans la bouche de ceux qui prêchent la modération, et la paix dans celle de personnes considérées comme extrémistes. Ce n’est pas une répartition facile à faire.
C’est pour cela que je dois faire l’effort d’accorder à la notion de doute une valeur quasi spirituelle et poser comme possible le fait que l’on peut s’être partiellement trompé, que l’autre a partiellement raison et qu’à deux, nous constituons une sorte de vérité à plusieurs facettes. N’oublions pas cette sentence talmudique que l’on applique aux grandes controverses : « Tant celle-ci que celle-là sont les paroles du D. vivant ».
Quant à ce qui m’indispose particulièrement : le repli sur soi, le désintérêt pour la culture et par-dessus tout, un certain sentiment de supériorité.
Et cela participe de mon amitié élective envers le Grand Rabbin Jonathan Sacks, de mémoire bénie.
Mais encore ?
Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que le Grand Rabbin Sacks était, si je peux me permettre, un inquiéteur dans une société bien pensante où la réussite matérielle comme but ultime va de soi et où l’emprise des médias fait un formidable bruit qui empêche de penser. Dans un tel contexte, loin des messages convenus, Jonathan Sacks a su maintenir la part d’étrangeté et de questionnement qui sont au cœur du judaïsme.
« Influencer n’est pas modeler, ni même exercer une emprise »
Parlons de vos maîtres…
L’expérience essentielle de ma formation aura été la rencontre inespérée, après mes études rabbiniques à Paris, avec celui qui accepta de devenir mon maître en Torah : rav Yehiel Landa, de mémoire bénie. Cet homme qui avait lui-même été formé par les plus hautes sommités rabbiniques de la Lituanie d’avant-guerre, et particulièrement par le Gaon de Rogatchov à Dvinsk, m’a fait l’immense confiance de m’ouvrir les portes d’un certain monde de Torah qui, sans lui, m’aurait à jamais été fermé.

La puissance pénétrante et la hauteur de vue de cet homme qui comptait parmi les habitants les plus rigoureux de Mea Shearim, reste pour moi source d’espoir et d’inspiration.
Mon directeur à l’Ecole rabbinique de Paris, le Grand rabbin Henri Schilli, fut mon maître en humanité. Comment en parler ? Sans doute en gardant à l’esprit qu’influencer n’est pas modeler, ni même exercer une emprise. Il s’agit ici de la rencontre singulière entre un art du contact et une manière de parler chez un homme dont la simplicité était lumineuse. Il y avait dans son comportement si attentif à la moindre inflexion des rapports humains, une loyauté sans failles à un petit nombre d’exigences posées en fondation.
Tout ce qui pouvait impressionner, en imposer avait été écarté d’emblée. Ce premier « déblaiement » fait, le véritable travail pouvait commencer : aller sans mensonge, sans souci de paraître ni de provocation. Le courage, la justesse et – osons le dire – la bonté sont des qualités trop rares pour que nous hésitions à avouer combien nous manque aujourd’hui la présence de celui auquel nous sentions, d’instinct, que nous pouvions nous confier.
Quant à des philosophes ? Toute sélection serait injuste. Au pied levé, je dirais que j’apprécie l’ironie de Montaigne et sa manière de déconstruire une citation – à l’image du Talmud – et d’en tirer des enseignements.
Nietzsche et Dostoïevski, chez lesquels tout ce qui console et propose des refuges est à éviter, y compris parfois la métaphysique. « Le summum de ce que peut faire un homme pour un autre est de le rendre inquiet » disait très justement Kierkegaard. On pourrait parler à leur propos de malades de l’esprit dont l’action est bienfaisante car infiniment décapante.
Très éloigné de Nietzsche par de nombreux aspects, j’aime néanmoins son intelligence hors du commun. Sa langue, unique au monde, s’apparente à la musique.
Enfin, Chestov m’a appris à lire certains écrivains dont les idées se situent aux antipodes des miennes. J’ai compris grâce à lui qu’avant de critiquer, il importe d’entrer, sans complaisance mais avec respect, dans la position d’autrui. L’homme banal juge erroné ce qu’il est incapable de saisir. Ce qui dépasse son niveau lui semble inopportun et soulève son irritation.
Être rabbin, c’est « être là »
L’enseignement constitue l’une des activités majeures de votre vie : le rôle de passeur n’est-il pas celui que vous préférez ? Osera-t-on vous faire remarquer que l’homme plutôt posé que vous êtes ne s’enflamme jamais autant que lors de ses cours, porté soudain par l’enthousiasme et le désir de transmettre ?
Être rabbin, c’est être passeur par l’enseignement mais pas seulement. Je dirais qu’être rabbin, c’est « être là ». Vous allez me dire que cela pourrait être l’exigence de tout homme. Mais pour le rabbin, c’est non seulement une exigence, c’est l’engagement de toute une vie : être un veilleur. Se tenir près des hommes, auprès d’eux, à la juste distance qui est celle de la veille, de l’écoute, de l’accueil et de la présence active et fidèle.
Homme parmi les hommes : dans le quotidien de la prière, à la synagogue, dans mon bureau où les gens viennent me voir, dans la salle de cours, à l’hôpital où il s’agit d’être activement là, y compris dans le silence. De veille à éveil, il n’y a qu’un pas. Car le rabbin a charge de favoriser cet éveil à soi-même, ce questionnement : que signifie vraiment, pour chacun de ceux que je rencontre, et ce dans la vérité la plus intime, être juif ? Le rabbin est aussi un passeur, celui qui fait « passage » entre la grandeur des Textes, des maîtres, de la Tradition, et les besoins des hommes. Comment la Transcendance dont il témoigne va-t-elle s’incarner dans la chair des hommes et dans le tissu des jours.
C’est l’urgente question – car le malheur abonde – que le rabbin porte en lui, chaque matin, en se levant. Ou bien en commençant son cours.
Est-ce la raison pour laquelle vous avez souvent affirmé qu’il ne suffit pas d’écouter « religieusement » l’enseignant et qu’il ne faut pas, au sortir du cours, avoir le sentiment « d’appartenir à une élite » ?
Je n’oublie pas le rôle central du rabbin : celui d’enseigner la Loi juive, la Tradition juive et d’apporter son aide à tous, afin que chacun soit en mesure de se déterminer à partir de sa liberté fondamentale. Être porteur d’une identité, juive par exemple, ce n’est pas la revendiquer par la force et en opposition aux autres. C’est avant tout défendre la complexité de la vie, la liberté des individus et en tirer le devoir de reconnaître l’identité des autres pour apprendre à vivre ensemble. Je ne souhaite pas, en tant que rabbin qui aime enseigner, voir mes auditeurs repartir de mes cours avec le sentiment d’appartenir à une élite qui serait le judaïsme mais avec un peu plus de confiance investie dans le fait d’être juif parmi les hommes.
Le choix d’Israël comme peuple élu ne se nourrit pas de privilèges mais d’un plus d’obligations envers tous les hommes.
C’est ce que la Tradition talmudique rigoureusement pratiquée et étudiée avec intelligence nous apprend chaque jour.
Vous exhortez votre auditoire à repenser votre cours avec « ses propres mots » comme votre mère, professeure de mathématiques, le faisait avec ses élèves…
Elle fut ma professeure de mathématiques en classes de 4e et de 3e au lycée d’Aix-les-Bains. Elle nous disait : « En rentrant chez vous, fermez votre cahier et votre livre et refaites de mémoire la démonstration du théorème que j’ai faite en classe devant vous », « Inutile d’acheter des annales et de faire beaucoup d’exercices », « Refaites la démonstration sans vous servir de vos notes et faites, pour vous rassurer, un exercice d’application et cela suffira ».
Ce n’est que plus tard que j’ai compris l’importance de la méthode. Plutôt que de photographier mentalement le parcours de la démonstration emprunté par le professeur ou le livre, il faut le construire par nous-même avec nos propres mots, nos propres circuits mentaux afin de ne pas seulement devenir le dépositaire d’un enseignement mais d’être aussi et surtout l’architecte de la reconstruction de la démonstration, avec nos propres mots et nos propres circuits mentaux.

Les mots et les structures étant nôtres désormais, ils nous habitent, ils vivent en nous et nous permettent d’autant plus facilement d’en faire bon usage. Nombre de ses anciens élèves lui en sont, aujourd’hui encore, reconnaissants parce qu’une méthode pour la vie, c’est plus important qu’une bonne note.
« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde », selon la phrase de Camus. Mettre des mots justes : n’est-ce pas là votre quête obsessionnelle ?
Mettre des mots justes, oui, mais souvent, les mots justes arrivent en retard… Pour tout vous dire, j’ai lu, en 1976 je crois, La femme gauchère de l’écrivain autrichien Peter Handke. Il n’y a rien d’exceptionnel, rien de particulier chez Peter Handke, son « génie » n’est qu’attention. Il dit de façon juste – et tout son effort est dans cette justesse – ce que chacun a déjà ressenti mais à quoi peut-être les impératifs et les obligations de la vie quotidienne lui ont interdit de prêter attention. Tout ce qui, chez chacun, du fait même des nécessités de la vie quotidienne et des obligations, s’est arrêté à mi-chemin, à frange de conscience, sous-jacent et informulé, se trouve tout à coup exprimé clairement par les textes de Handke.
C’est comme si chaque lecteur retrouvait ce qu’il a déjà entendu, comme si une voix grandissait en lui qu’il reconnaît, comme s’il voyait soudain ce qu’il n’a jamais regardé ainsi. C’est un peu comme lorsqu’on change d’itinéraire dans une ville familière : tout ce qu’on connaît si bien apparaît comme on ne l’avait jamais encore vu.
Nombreux sont celles et ceux qui témoignent, à votre encontre, d’une profonde reconnaissance, parce que c’est dans vos mots que les endeuillés ont puisé le réconfort qui les a accompagnés dans leur moment douloureux. Là encore, les mots justes ?
Les mots justes, oui, mais en prêtant attention à deux choses. Lorsqu’on parle « à » une personne qui souffre, on ne lui parle pas « de » quelque chose extérieur à ce qu’elle vit ; on s’adresse à cette personne avec l’espoir de mettre des mots aussi justes que possible sur l’objet de sa souffrance, car dans le deuil, cette souffrance est, pour cette personne, unique et doit être respectée.
Ce n’est ni le moment de délivrer de grands enseignements, ni celui de parler de l’expérience de la souffrance chez d’autres personnes. Parler « à… » et non « de… » est une manière de respecter la souffrance de l’autre sans chercher à la mettre en perspective avec d’autres souffrances et, de la sorte, la banaliser. Ce respect permet le véritable accompagnement.
Mais pour cela, il faut avoir été formé à préparer le mourant à sa mort : car celui-ci, contrairement à l’opinion générale, a parfois besoin qu’on lui parle d’elle et qu’on l’assume avec lui comme son dernier acte de vivant. Aux Etats-Unis, par exemple, nombre de rabbins sont formés à cela. En Israël, un programme scolaire intitulé « valeurs humaines » met les élèves de seize/dix-sept ans en face de l’expérience de la mort. Non seulement il fait de la considération de la mort un approfondissement de la vie mais il pose, à propos du pouvoir sur la vie elle-même, des questions qui, en France, paraissent taboues. Qu’en est-il de nos rabbins ?
« Un nouveau rôle du rabbin se développe depuis quelques dizaines d’années : c’est celui d’un véritable travailleur social »
Vous avez été Grand Rabbin de France. Quel souvenir en gardez-vous ?
Trop de souvenirs nuisent à la clarté du propos et n’expriment alors que des généralités. Parmi les trois ou quatre investissements majeurs qui furent les miens, entre 2008 et 2013, il y a l’Ecole Rabbinique dont la refonte m’était apparue souhaitable.
Dans quel sens ?
Cette école rabbinique avait aux origines pour mission de fournir aux élèves-rabbins le cadre d’une double formation : une compétence dans les matières de Kodesh et une formation de niveau universitaire dans des disciplines profanes (sciences tout court ou sciences humaines) ou dans les études juives de type académique. Cette école doit ainsi préparer les rabbins à une partie centrale de leur travail dans les pays et les communautés comme les nôtres, maîtrisant les deux langages, celui de la Tradition juive et celui de la culture européenne, de manière, d’une part, à pouvoir expliquer et faire respecter d’emblée le judaïsme à ceux qui n’en ont aucune idée et d’autre part, à pouvoir médiatiser auprès des fidèles des savoirs scientifiques, techniques ou de cultures susceptibles d’avoir des incidences sur les plans halakhique ou moral. Je pense à la bioéthique ou aux avantages et inconvénients de l’électronique par rapport au Shabbat, ou aux croyances et aux découvertes qui « confirment » ou « réfutent » les enseignements du judaïsme. Le rabbin doit savoir de quoi on parle et comment répondre.
Un nouveau rôle du rabbin se développe depuis quelques dizaines d’années : c’est celui d’un véritable travailleur social qui doit savoir répondre non seulement, comme en tout temps, aux détresses provoquées par la maladie et la mort, mais aussi à celles de l’exclusion (chômage, solitude, sida, grand âge…), aux difficultés ou violences familiales, aux incertitudes de toutes sortes.

C’est dire si l’école rabbinique est une institution importante et c’est dire si l’enseignement qui s’y donne a besoin d’être complété. Ce fut une priorité de mon action, trop courte.
Il semble que certaines solutions soient assez faciles à mettre en œuvre : d’abord, bien peu veulent entrer dans une école qui semble oubliée des autorités. Ensuite, il faut que ce qu’on y fait soit bien clair : formation exigeante en Torah, incitation à suivre un cursus universitaire sérieux et formation systématique au travail social. Puis, il faut que les conditions d’exercice du futur métier et de « carrière » soient clarifiées : quels conseils trouveront les débutants, quel appui pour assurer une vie juive complète à leur famille dans certaines communautés isolées et peu équipées ou simplement pour se documenter en vue de leurs enseignements, quelles responsabilités plus importantes ils peuvent espérer plus tard et à quelle échéance.
Vous avez, depuis le début de cet entretien, cité plusieurs écrivains. Peut-on, en quelques mots, évoquer ceux qui vous tiennent particulièrement à cœur ? Roth, Appelfeld, Kundera ou encore Musil dont la référence apparaît dans certains de vos cours ?
Quelques mots ne suffisent pas : Philip Roth, comme Aharon Appelfeld ou Milan Kundera, nos contemporains, mériteraient chacun le prix Nobel de Littérature et la place qu’ils occupent dans ma vie dépasserait le cadre de cet entretien.
Robert Musil ? Impossible à son sujet de ne pas parler de Vienne et d’éluder la question de l’antisémitisme. J’indiquerai seulement à ce propos trois paradoxes.
D’abord, c’est précisément dans la ville de Mahler, de Freud, de Joseph Roth, de Schönberg, de Broch, c’est-à-dire dans la ville où le monde juif semblait, sur le plan culturel, le plus présent, le mieux intégré, au point souvent de croire son assimilation définitive, que s’est développé, simultanément, un antisémitisme de masse qui devait trouver son accomplissement dans l’acceptation, par la majorité des Viennois, de l’annexion au Reich hitlérien et de l’exil qui s’ensuivit des intellectuels et artistes juifs les plus prestigieux. Comme s’il n’était pas de racisme plus virulent que celui de la « plus petite différence ».
Par ailleurs, cet antisémitisme, manifestement, est encore largement présent, ne serait-ce qu’à titre de préjugé dans la Vienne d’aujourd’hui, alors que le nombre de Juifs est infime. Comme si l’antisémitisme, au fond, ne dépendait même pas de la présence physique réelle des Juifs, ce qui devrait nous faire réfléchir sur les douteuses théories concernant les seuils de tolérance. Il nous faut néanmoins souligner que l’Autriche après avoir des décennies durant entretenu le mythe d’un pays victime du nazisme parle maintenant de culpabilité partagée avec l’Allemagne nazie. C’est une avancée très importante.
Enfin, c’est précisément dans l’une des villes les plus cultivées du monde que l’antisémitisme s’est développé avec une telle intensité – ce qui bouleverse l’idée reçue selon laquelle seule la culture pourrait faire rempart à la barbarie.
Ces trois paradoxes, pour l’essentiel, restent à penser : aucune des théories courantes sur le racisme et l’antisémitisme ne parvient complètement à en rendre compte. Or, il me semble que ce qui pourrait nous y aider le mieux, ce n’est pas tant le point de vue des philosophes ou des psychanalystes mais, dernier paradoxe, celui des romanciers. Car, finalement, où l’effort d’analyse de cette question est-il le plus avancé ? Je suggérerais ceci : chez Musil, dont la mise en scène du tourbillon idéologique viennois, sur fond de « vide des valeurs » de L’homme sans qualités ne concerne pas seulement l’Autriche d’avant 1914 ; et chez Hermann Broch, celui qui, dans ses romans Le Tentateur ou Les Irresponsables, aura le mieux cerné le phénomène « de l’intérieur ».
Un mot encore, sur Kafka, si vous le permettez. Son génie relève d’un paradoxe, celui de se sentir « exilé » sans pratiquement jamais quitter son lieu natal. Ce qui, coïncidence peut-être, n’est rien d’autre que l’expression d’une idée talmudique qui rappelle que l’exil du peuple juif n’est pas qu’une catégorie historique liée à des avatars économiques ou politiques – ceux qui suscitent les migrations, les déplacements. C’est, au sens fort, une catégorie métaphysique, une intolérance à tout ce qui s’accroche trop exclusivement au sang, au sol, à la force. Pour que le Juif, se sachant en tout et en tout lieu comme « étranger » à tout ce qui ne serait qu’identité « naturelle », par opposition à l’identité culturelle ou religieuse, redouble de vigilance dans sa responsabilité à l’égard de l’étranger. Sur la terre d’Israël comme ailleurs.
Vous aurez compris la place importante occupée par la littérature d’Europe Centrale, pour ces raisons et pour tant d’autres encore.
La vigilance que vous appelez de vos vœux s’impose également, venez-vous de dire, « Sur la terre d’Israël comme ailleurs ». Pouvez-vous préciser ?
Pour approfondir la thématique que vous soulevez, il faut noter que derrière cette interrogation, on perçoit une question restée sans réponse, qui domine la pensée sioniste : la nation hébraïque, en recouvrant sa terre et sa souveraineté, va-t-elle renoncer à la tradition unique qui est celle du peuple juif ? Va-t-elle devenir une nation comme toutes les autres ? La pierre angulaire sur laquelle repose toute la pensée juive va-t-elle manquer sous les pas des Juifs ? Le peuple juif sur sa terre se distinguera-t-il des autres peuples simplement comme les Français diffèrent des Anglais ? Ou bien va-t-il conserver quelque chose de son message universel, quelque chose d’unique, une altérité – l’héritage de son passé – dans ce monde auquel il veut s’intégrer ? S’il devait devenir une nation comme les autres, qu’adviendrait-il de cet héritage qui l’avait placé à part du reste du monde ? Si le sionisme devait le déposséder de cet héritage légué par le judaïsme, que resterait-il de la destinée juive ? Serons-nous nous-mêmes en nous séparant de nous-mêmes ?
Quel souvenir gardez-vous de vos rencontres avec Aharon Appelfeld ?
La première rencontre s’est déroulée à Paris, lors d’une conférence donnée par l’écrivain. Mon épouse et moi-même ne remercierons jamais suffisamment Valérie Zenatti, sa traductrice, de nous avoir, ce jour-là, spontanément invités chez elle, afin de partager, au vendredi suivant, le repas de Shabbat aux côtés du couple Appelfeld.

Cette soirée reste dans notre vie un moment d’exception, comme hors du temps. Elle fut suivie d’autres rencontres en Israël, avec Judith et Aharon Appelfeld, un couple superbe, rare.
Je repense souvent à cette chaleureuse attention qui émanait du visage d’Aharon, visage qui avait gardé quelque chose de l’enfance. Mais aussi à la chaleur spirituelle qui venait de ses mots, si précis, simples et profonds.
On vous sait également mélomane. Quelle œuvre vous vient-elle spontanément à l’esprit ?
Au programme, la Waldstein et l’Appasionnata. Au piano Rudolf Serkin.
Une soirée avec Serkin, c’était de toute façon une leçon de vie. Lui-même répugnait à ce que l’on parle de lui. Il n’y avait rien à savoir de lui, qu’à le regarder faire.
Ceux qui ont vu cela ne risquent pas de l’oublier. La Waldstein et l’Appasionnata ne disant rien de Serkin mais disant tout de Beethoven.
À ceux qui ne l’ont pas vu, on ne peut que donner une idée, abstraite : sans emprise, régénératrice.
L’effacement de soi de Serkin était si authentique qu’on peut ignorer ses gestes de pianiste, sa façon d’entrer en scène, de saluer. Il n’y a pas à imaginer Serkin. Tout est passé dans le son, d’une énergie contraignante qui vous colle à votre siège, fixé dans l’écoute et c’est resté vrai au disque.
J’ai vu des amis suivre les presque trois quarts d’heure de sa Hammerklavier, sans broncher ni bouger. C’était Serkin ne desserrant pas sa prise et vous forçant à entendre Beethoven.
Aucun pianiste n’a autant travaillé à son propre anonymat, disparaissant tout entier dans ce qu’il manifestait tout entière : Hammerklavier, Les Adieux ou Wanderer Fantaisie de Schubert. Quand on s’est dit cela, on en sait assez sur Rudolf Serkin. Il n’y a peut-être pas une note dans toute sa carrière qu’il n’ait jouée avec le désir de plaire.
Mon maître en musique, comme il y eut un maître en Torah et un maître en Humanité.
L’on ne saurait, Monsieur le Grand rabbin, faire l’impasse sur le sport d’autant que vous rappeliez, au début de notre entretien, combien les paysages de votre enfance sont propices au vélo, au ski et à l’alpinisme. Trouvez-vous le temps de pratiquer une activité
sportive ?
Trop peu. Dans ma Savoie natale au relief très accidenté, j’ai fait beaucoup de vélo au point de rêver, à l’âge de douze-treize ans, de faire de la compétition. J’ai alors demandé à mes parents l’achat d’un vélo de course afin de pouvoir m’inscrire au club cycliste local. Je m’attendais à ce qu’ils soulèvent le problème du Shabbat, de la casheroute. Mais ils m’ont simplement répondu : « La vie physique d’un sportif qui veut réussir en compétition est tellement intense et fatigante que tu n’auras plus la force et l’envie d’ouvrir des livres et d’étudier. Et un Juif qui ne lit pas n’est pas un bon Juif ».
J’ai été déconcerté et n’ai plus posé la question.
Dans Et il dit (Gallimard, 2012), Erri de Luca fait de Moïse un alpiniste courageux, équilibriste sûr de ses appuis, connaisseur du vent, sportif émérite et humble : qu’inspire au montagnard que vous êtes cette figure ainsi décrite par de Luca ?
Je ne connais pas ce texte mais il évoque plus pour moi Erri de Luca que Moïse. Ailleurs, cet écrivain fait de Moïse un pasteur menant paître le troupeau de Yithro qui n’était pas encore son beau-père. Il ajoute que les meilleurs bergers vont aux limites du désert ; au cas où un improbable orage secouerait un peu de nuages sur la steppe, il vaut mieux se tenir prêt pour être le premier à en profiter. Moïse faisait ainsi de longues étapes sur les flancs du désert et fut attiré par un feu, un buisson en flammes… Mais il revenait de ses tours solitaires avec un bétail gras. Il était le meilleur des bergers d’Yithro. La preuve, c’est qu’il épousa sa fille.
Erri de Luca toujours : « Il n’est pas demandé au gardien de troupeaux d’en augmenter les têtes, d’en acquérir de nouvelles, au-delà des cycles de naissances internes ». Ainsi fait le récit biblique, qui se concentre sur un seul peuple – le peuple hébreu, plutôt mis en isolement, séparé qu’élu mais vivant l’expérience de la transformation. À l’image de Moïse, le peuple juif s’occupe de la qualité du nombre confié et ne part pas en quête d’annexion d’autres troupeaux.
Les figures féminines sont nombreuses dans la Torah. L’une d’elles retient-elle particulièrement votre attention ?
Myriam, indéniablement, qui est nommée prophétesse parce qu’elle était l’une des deux sages-femmes qui avait su contourner le décret qui, en Egypte, frappait les nouveaux-nés hébreux mâles. Elle a ainsi permis de préserver la vie de ces nouveaux-nés. Rachi ajoute qu’une autre de ses qualités fut de prophétiser la naissance de Moïse auprès de ses parents qui, pour ne pas voir un éventuel nouveau-né mâle être tué, avaient mis fin à toute vie conjugale. Elle a donc fait en sorte que des enfants qui ne devaient pas vivre ou qui ne devaient pas même être conçus puissent l’être.
Nous comprenons mieux, dès lors, ce commentaire du Midrash nous enseignant que celui qui sait donner la vie aux enfants inspire confiance aux adultes et enrichit la capacité d’écoute des parents. Myriam favorisait la structuration de la capacité d’écoute de chacun. Tant qu’elle vivait, la parole de Moïse était entendue à la juste mesure de la capacité d’entendement de chacun et ce, par la grâce des qualités de prophétesse de sa sœur.
Myriam mobilise la meilleure part d’autrui pour permettre à chacun d’accueillir ce à quoi il n’est pas nécessairement préparé. C’est grâce à Myriam que la parole de Moïse est entendue, au meilleur de son contenu.
Allez-vous continuer l’émission radiophonique « Torah et Société » ?
Oui, par Skype depuis Jérusalem, le dimanche soir pour Paris, de 19h 30 à
20 heures. Une émission qui a plus de 20 ans d’âge sur Radio Shalom, avec Pierre Gandus.
Comment votre vie va-t-elle s’organiser en Israël ? Allez-vous vous partager entre vos enfants et petits-enfants ? D’ailleurs, quel grand-père êtes-vous ?
Je vais étudier mais surtout apprendre, enseigner et peut-être écrire. Intégrer la vie associative pour le social et quelques autres projets. Mais il faut toujours tenir compte de l’écart qui se crée pour de multiples raisons contingentes, entre le désir et la réalité. Les enfants et les petits-enfants, cela va de soi.
Vous me demandez quel grand-père je suis. La réponse n’appartient qu’à mes petits-enfants et accessoirement à leurs parents.
« La grandeur de la Torah réside aussi dans sa capacité à donner à penser à ceux qui ne croient pas en elle »
Pour conclure cet entretien, Monsieur le Grand Rabbin, quel rôle la Torah peut-elle avoir dans notre société qui a bien des raisons de se sentir déstabilisée ?
Si l’on tient compte des observations faites ici sur le doute, le passeur, l’inquiétude et quelques autres convictions, il est difficile d’imaginer la vie de l’esprit comme un long fleuve tranquille.
Mon maitre en Torah, le rav Yehiel Landa, me faisait observer que la Torah apporte de la lumière là où il y a de l’obscurité, mais aussi de la pénombre là où la lumière de l’évidence nous fascine, voire nous aveugle. Milan Kundera aurait pu ajouter : pour rendre la légèreté de l’être un peu plus soutenable.
Mais si je devais conclure, c’est par une observation de fond que je le ferais.
Le retour du religieux paraît se faire aujourd’hui dans la confrontation et l’antagonisme, face à des sociétés perçues comme perdant leurs valeurs et porteuses d’illusions. Comme si une forme de réappropriation du religieux ne pouvait se faire que dans la négation de l’altérité, dans une projection vers un futur idéalisé qui gomme conjointement le présent et le passé, parce que trop complexes ou douloureux.
Maintenant, si l’on veut bien sortir des logiques simplistes et hâtives, on peut imaginer toutes sortes de ponts, de canaux, d’échanges et de dialogues qui permettront aux religions, plus qu’elles ne le font- et la Torah tout particulièrement – d’être associées aux débats de la cité ; d’aider la société à sortir des ornières, de contribuer à éclaircir ses choix, d’imaginer des solutions porteuses d’espoir pour tous.
En tant que Juif et reprenant en cela l’enseignement d’un maitre de la Tradition juive, j’ai la conviction que la grandeur de la Torah réside aussi dans sa capacité à donner à penser à ceux qui ne croient pas en elle.
Content retrieved from: https://fr.timesofisrael.com/avant-son-alyah-gilles-bernheim-se-confie-longuement-au-times-of-israel/.





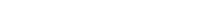





You must be logged in to post a comment Login